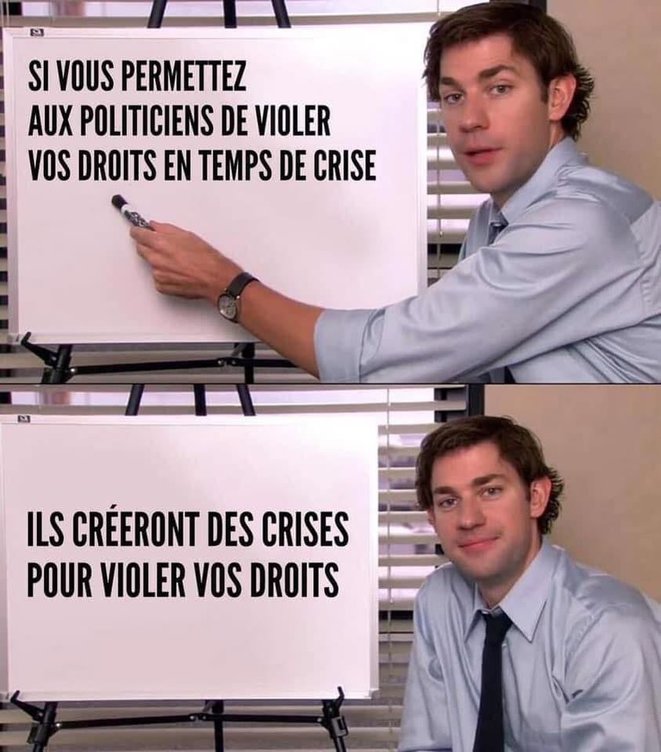Pourquoi la vaccination obligatoire anti-covid viole l’Etat de droit
- 21 juil. 2021
- Par Laurent Mucchielli
- Blog : Le blog de Laurent Mucchielli
Épisode 57
Par Philippe SEGUR, professeur de Droit public à l’Université
Dans le débat sur la vaccination obligatoire, il est fréquent d’entendre que les vaccins anti-covid ne sont plus dans une phase expérimentale (voir par exemple dans Le Quotidien du médecin). Si ce propos peut se comprendre quand il vient de citoyens non formés au droit, il surprend davantage quand il émane de juristes. Car il relève davantage de l’opinion personnelle ou d’un emprunt à un certain discours médical que d’une lecture attentive des textes juridiques. Cette affirmation offre, il est vrai, l’avantage de simplifier la discussion et de faire l’économie d’une réflexion éthique. Elle permet de rappeler l’existence d’autres vaccins obligatoires pour les personnels de santé (selon les professions : diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B) ou pour les enfants (poliomyélite, diphtérie, tétanos, etcétéra), de considérer que le Conseil constitutionnel (décision du 20 mars 2015) et la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt du 8 avril 2021) ont déjà tranché et, si l’on veut faire appel aux grands principes, d’indiquer que l’inviolabilité du corps humain n’est pas absolue et qu’elle peut supposer des contraintes au nom de l’intérêt général, en l’occurrence de la santé publique.
Cependant, parce qu’on se refuse à examiner la question préalable de la qualification de la vaccination anti-covid, c’est l’ensemble du raisonnement juridique qui se trouve biaisé. Non seulement les comparaisons avec les autres vaccins ne sont pas recevables, parce que les situations sont différentes et appellent des règles différentes, mais le droit en général n’a pas à se plier à la sémantique ou à la rhétorique médicale. S’il possède en matière d’éthique son propre lexique et ses propres définitions, c’est précisément pour éviter que l’expert médical instrumentalisé par le pouvoir n’en vienne à dicter sa loi.
Le ministère de la Santé a récemment défendu une curieuse ligne argumentaire pour justifier la licéité de l’obligation vaccinale. Il y aurait une distinction à faire – inconnue jusqu’alors – entre une phase de recueil des données qui seule serait expérimentale et la suite des essais cliniques qui ne relèveraient pas de l’expérimentation. Il est regrettable que certains emboîtent le pas de ce discours politico-médical et s’empressent de discuter d’une obligation vaccinale ordinaire comme si la question de l’expérimentation était réglée, ce qu’elle n’est pas. Car aucun texte ne fonde la distinction du ministre. Aucun critère juridique objectif ne permet de savoir quand les recueils de données feraient perdre aux essais cliniques leur caractère expérimental. Le droit est étrangement absent de ces affirmations. Pourtant, en matière de recherches médicales sur l’être humain, il y a du droit. Et celui-ci dit le contraire de ce que prétend le ministère de la Santé.
Qu’est-ce qu’un essai clinique ?
Commençons par les distinctions en usage dans le domaine pharmaceutique et médical. Sur le plan médical, il existe quatre phases d’essais cliniques : 1°) Les essais de phase 1 concernent un petit groupe de volontaires en bonne santé, hébergés dans des centres spécialisés, sur lesquels on vérifie que le médicament ne comporte pas de risque majeur par l’étude de sa toxicité et de sa cinétique, c’est-à-dire de son devenir dans l’organisme ; 2°) Les essais de phase 2 testent en milieu hospitalier la tolérance et l’efficacité du traitement sur des dizaines de personnes – des malades lorsqu’il s’agit d’un médicament thérapeutique – afin notamment d’en évaluer le dosage ; 3°) Les essais de phase 3 visent à mesurer l’efficacité et la sécurité du produit. Comme le rappelle l’INSERM, ils comparent le traitement à un autre traitement ou à un placebo en l’administrant à des centaines, voire des milliers de volontaires répartis en deux groupes au hasard, par « randomisation ». C’est seulement une fois que les essais cliniques de phase 3 sont terminés que peut éventuellement être délivrée une autorisation de mise sur le marché (AMM). 4°) Les études de phase 4 (post marketing) visent à évaluer les effets du médicament à long terme sur toute la population dans le cadre d’une utilisation habituelle par les prescripteurs médicaux. C’est le stade de la pharmacovigilance.
Pour les médicaments innovants, ou contenant une nouvelle substance active, ou luttant contre les maladies virales et dans les cas d’urgence, une procédure communautaire centralisée d’autorisation obligatoire a été instaurée sur le plan européen. Les vaccins anti-covid Pfizer, Moderna, Astrazeneca et Janssen ont ainsi bénéficié d’une autorisation dérogatoire de mise sur le marché délivrée par l’Agence européenne des médicaments, bien qu’ils se trouvent encore au stade des essais cliniques de phase 3, mais à la condition de terminer ces essais. Ceux-ci s’achèveront le 27 octobre 2022 pour Moderna, le 14 février 2023 pour Astrazeneca, le 2 mai 2023 pour Pfizer.
Ces distinctions entre les diverses phases des essais cliniques ne sont pas reprises par le droit qui encadre les recherches médicales. L’expression d’expérimentation médicale sur l’être humain elle-même, parce qu’elle est à forte charge polémique, tend à disparaître des textes français qui lui préfèrent d’autres qualifications. Il semble donc que, dans le débat public actuel, il y ait à la fois une confusion entre le sens ordinaire et le sens scientifique du terme « expérimentation » et une inadéquation entre celui-ci et la terminologie que le droit utilise. Certes, le juriste demeure libre de parler d’expérimentation au sens ordinaire, notamment par souci pédagogique, mais à condition d’avoir d’abord qualifié la situation dans les termes exacts avec lesquels le droit l’appréhende.
Ce n’est pas là simple bataille de mots ni vaine querelle de spécialistes, car l’enjeu se révèle majeur. Admettre que la médecine, adossée au pouvoir politique, puisse définir ou redéfinir librement ce qui procède de l’expérimentation médicale et ce qui n’en procède pas serait une formidable régression juridique. Ce serait revenir plus d’un siècle en arrière, à l’époque où le médecin-expérimentateur était seul juge de ce qui était bon pour le patient et ne s’embarrassait pas de son consentement pour pratiquer sur lui des essais parfois dangereux (voir ici un rappel de quelques cas au 19ème siècle). Il a fallu près d’un siècle pour que s’impose sur ce point un droit protecteur des personnes à tous les étages de l’ordre juridique – international, européen et national. Il paraît inconcevable et inquiétant que des règles éthiques prévues non seulement pour des situations ordinaires, mais aussi pour des situations exceptionnelles – comme en atteste le Code de Nuremberg qui fut, en 1947, un temps fort de cette élaboration juridique – soient écartées à l’occasion d’une crise, fût-elle sanitaire. Ce serait là mettre gravement en danger une construction juridique humaniste et libérale qui est l’une des œuvres les plus nobles du droit occidental de la fin du XXe siècle.
S’il ne s’agit pas de contester par principe le bien-fondé de la vaccination dont les bénéfices (éradication de la variole et, quasiment, de la poliomyélite, entre 1988 et 2016) ne sont plus aujourd’hui à démontrer, il paraît nécessaire de rappeler, dans un débat trop souvent passionnel, quelles sont les règles qu’au fil du temps, la raison juridique a élaborée dans l’intérêt de chacun et qu’elle a voulu poser au-delà des contingences historiques. Bien que d’autres textes en vigueur aillent dans le même sens, la présente étude se limitera à l’examen du droit de l’Union européenne et du droit interne français. L’un et l’autre suffisent, en effet, à apporter des réponses à trois questions importantes : Que dit le droit des essais cliniques ? Comment peut-il qualifier les vaccins anti-covid ? Une fois les essais cliniques définis et les vaccins qualifiés, quelles sont les règles juridiques applicables ?
Les essais cliniques de phase 3 : des recherches interventionnelles sur l’être humain
Le droit de l’Union européenne donne une définition claire des essais cliniques. Selon la directive du 4 avril 2001, il s’agit de « toute investigation menée chez l’homme, afin de déterminer ou de confirmer les effets cliniques, pharmacologiques et/ou les autres effets pharmacodynamiques d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, et/ou de mettre en évidence tout effet indésirable d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, et/ou d’étudier l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination d’un ou de plusieurs médicaments expérimentaux, dans le but de s’assurer de leur innocuité et/ou efficacité » (art. 2, a). Ce texte ne distingue pas selon les phases, mais considère que toutes les investigations menées sur des personnes afin d’évaluer un médicament sont des essais. Il n’y a donc pas, dans les essais cliniques, une phase qui pourrait cesser d’être expérimentale, puisque, par définition, un essai clinique porte sur un médicament expérimental.
La notion d’essai clinique repose, en effet, sur trois critères : une intervention sur l’organisme humain (à la différence de l’essai pré-clinique qui a lieu sur l’animal), un médicament expérimental utilisé pour cette intervention et une finalité qui est de mesurer les effets de ce médicament. C’est la combinaison de ces trois éléments (l’intervention, le médicament expérimental, la mesure des effets) qui confère aux essais le caractère d’une investigation. Dès lors, le droit de l’Union européenne prévoit que toute demande d’autorisation d’un médicament à usage humain doit comporter « spécifiquement et exhaustivement » un certain nombre de renseignements et de documents (Règlement CE n°726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, déjà cité, art. 6). Parmi ceux-ci, figurent le « résultat des essais physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques, toxicologiques et pharmacologiques, cliniques » (Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, art. 8). L’adverbe « exhaustivement » est sans équivoque : il s’agit de tous les essais.
Dans des circonstances exceptionnelles (1), il est néanmoins prévu que certains médicaments peuvent recevoir une autorisation de mise sur le marché « avant que les données cliniques exhaustives ne soient communiquées » et ce pour une période d’un an renouvelable (Règlement (UE) 2019/5 du Parlement européen et du Conseil du 11 déc. 2018, déjà cité, art. 1er, 14). Dans ce cas, le titulaire de l’autorisation « est tenu d’achever les études en cours ou d’en mener de nouvelles afin de confirmer que le rapport bénéfice/risque est favorable » (Ibid). Loin de signifier que les essais cliniques sont terminés, le caractère conditionnel et limité dans le temps de l’autorisation démontre que le rapport bénéfice-risque ne sera confirmé que lorsque toutes les données auront été produites. C’est pourquoi le Règlement européen du 16 avril 2014 (préambule, 3) suggère de distinguer les essais cliniques des études cliniques. Notion plus large, les études cliniques sont celles qui ne comportent aucun risque pour les personnes et qui sont effectuées lors du traitement normal des pathologies. Ceci suggère que seule la restitution de la totalité des données des essais cliniques au sens strict permet d’obtenir une autorisation définitive et transforme les essais cliniques en études cliniques de pharmacovigilance.
Le droit français, quant à lui, évite d’utiliser les mots « expérimentation » et « expérience » qui peuvent inciter à la suspicion, voire à l’inquiétude. Il leur préfère, par euphémisme, la périphrase « recherche impliquant la personne humaine » depuis la loi Jardé de 2012. Si les termes sont édulcorés, la réalité qu’ils désignent demeurent la même. Les recherches impliquant la personne humaine sont des recherches pratiquées sur des personnes saines ou malades en vue d’évaluer l’« efficacité et la sécurité de la réalisation d’actes ou de l’utilisation ou de l’administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d’états pathologiques » (art. R1121-1 du Code de la santé publique).
On distingue alors trois catégories de recherches :
– Les « recherches non interventionnelles » qui ne comportent aucun risque et dans lesquelles les produits sont prescrits et utilisés de manière habituelle, c’est-à-dire sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance. À l’évidence, les essais pratiqués avec les vaccins anti-covid n’entrent pas dans cette catégorie.
– les « recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes » qui ne portent pas sur un médicament à usage humain. Les vaccins ne peuvent pas non plus entrer dans cette catégorie.
– les « recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle », c’est-à-dire par des soins normaux, et qui sont à risque (art. 1121-1, 1° du Code de la santé publique). Il ne fait aucun doute que les essais cliniques en cours pour les vaccins sont des recherches interventionnelles impliquant la personne humaine qui supposent le niveau de sécurité le plus élevé.
On remarquera que le droit français, comme le droit européen, ne fait pas de distinction entre les phases 1, 2 et 3 des essais (2). On ne trouve nulle part la mention de certaines données pharmacologiques ou médicales dont le recueil partiel suffirait à considérer que l’administration du médicament a perdu son caractère de recherche interventionnelle avant la fin officielle des essais cliniques de phase 3, comme l’a laissé entendre le ministre de la Santé.
Les vaccins anti-covid : des médicaments immunologiques expérimentaux
Selon Éric Muraille, professeur en immunologie à l’université libre de Bruxelles, « un vaccin est généralement dit expérimental quand il n’a démontré son efficacité et sa sécurité que chez l’animal », ce qui le conduit à conclure que les vaccins anti-covid ne le sont pas. Cette définition médicale de l’expression « vaccin expérimental » dont l’usage serait limité aux essais pré-cliniques sur l’animal, n’est pas celle du droit. Les vaccins sont qualifiés par le droit européen de « médicaments immunologiques » (3), formulation que reprend le droit français (art. L5121-1-6° du Code la santé publique). Les vaccins anti-covid peuvent-ils être considérés comme des médicaments immunologiques expérimentaux ? La réponse est positive, puisque, selon le droit de l’Union européenne, un médicament expérimental est un « principe actif sous forme pharmaceutique ou placebo expérimenté ou utilisé comme référence dans un essai clinique » (Directive 2001/20/CE du Parlement et du Conseil du 4 avril 2001, déjà citée, art. 2, d). Le droit français reprend encore cette définition (article L5121-1-1 du Code de la santé publique). On en conclut que du seul fait qu’ils sont en phase d’essais cliniques, les vaccins anti-covid sont bien des médicaments expérimentaux.
Le fait d’avoir reçu une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne des médicaments (EMA) fait-il perdre aux vaccins anti-covid leur caractère expérimental ? Selon la directive européenne du 4 avril 2001 (déjà citée, art. 2, d), l’expression « médicament expérimental » peut désigner les produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, mais utilisés « en vue d’obtenir de plus amples informations sur la forme autorisée ». C’est le cas des vaccins Pfizer, Moderna, Astrazeneca et Janssen. L’EMA leur a délivré une autorisation de mise sur le marché conditionnelle avant la fin des essais de phase 3 « sur la base de données moins complètes que ce qui est normalement requis » et à condition que les fabricants s’engagent à « fournir des données cliniques complètes à l’avenir ». Cette situation particulière est reçue par le droit français qui évoque, dans ce cas, un « médicament expérimental autorisé » (4). Les vaccins anti-covid doivent donc être regardés comme des médicaments immunologiques expérimentaux autorisés à titre dérogatoire.
Le consentement libre et éclairé : un principe éthique impératif
Si la vaccination anti-covid est non seulement légale, mais légitime pour les personnes qui en font le choix délibéré, la décision de la rendre obligatoire pour tout ou partie de la population suscite les plus grandes réserves. La comparaison avec les autres vaccins obligatoires prévus pour les soignants, les thanatopracteurs et les enfants n’est pas recevable, car ce sont là des vaccins éprouvés, dont les effets secondaires sont mineurs ou rares et les bénéfices incontestables. Les vaccins anti-covid sont dans une configuration différente : ce sont des produits récents à propos desquels les données demeurent incomplètes et les effets secondaires controversés. Comme le reconnaît l’immunologiste Éric Muraille, « nous ne disposons pas encore d’un recul important sur ces vaccins, la prudence reste donc de mise ».
Sur le chapitre de la prudence, le droit européen est d’une aide précieuse, car il définit la notion d’« usage médical bien établi » pour un médicament et renseigne sans ambiguïté sur ce qu’il faut entendre par cette expression. Elle suppose que le produit ou ses composantes aient « une efficacité reconnue ainsi qu’un niveau acceptable de sécurité » (Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, déjà citée, art. 10. 1. a). Or, d’après la directive du 6 novembre 2001 (annexe I, part. 2, I, a), « le laps de temps nécessaire pour démontrer que l’usage médical d’un composant d’un médicament est bien établi ne peut cependant pas être inférieur à dix ans comptés à partir de la première application systématique et documentée de cette substance en tant que médicament à l’intérieur de la Communauté ». Cela ne signifie pas qu’un recours précoce à des vaccins nouveaux n’est pas justifié : il l’est sans conteste pour les personnes qui en acceptent les risques éventuels. En revanche, que l’on puisse envisager de les rendre obligatoires heurte les principes éthiques les mieux admis par le droit depuis plus de trente ans (5).
Du moment qu’ils sont qualifiables de médicaments immunologiques expérimentaux, les vaccins anti-covid sont soumis, en effet, à des règles éthiques particulières dont la finalité est de protéger les individus. Au premier rang de ces règles, se trouve le principe du consentement libre et éclairé. La directive européenne du 4 avril 2001 actuellement en vigueur prévoit qu’un essai clinique ne peut être entrepris que si le sujet participant « a donné son consentement par écrit » et s’il peut, à tout moment et sans subir de préjudice de ce fait, révoquer « son consentement éclairé » (6). Le droit français est concordant, puisqu’il affirme qu’aucune recherche interventionnelle « ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé » (art. 1122-1-1 du Code de la santé publique). Cette obligation est assortie d’une sanction pénale, car le fait de pratiquer sur une personne une recherche ou un essai clinique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, en l’occurrence, écrit est passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (art. L1126-1 du Code de la santé publique et art. 223-8 du Code pénal).
Une objection ici ne manquera pas de surgir. Ceux qui se verront imposer la vaccination obligatoire n’appartiennent pas aux groupes de participants spécifiquement recrutés à chacune des phases des essais cliniques. Peut-on encore les considérer comme des « participants » ? La réponse ne peut être que positive. Bien qu’elles n’aient pas été « recrutées » par les promoteurs des essais ou par les investigateurs, les personnes soumises à une obligation vaccinale seront des participants de fait aux essais cliniques. Car si le droit européen (Directive 2001/20/CE du Parlement et du Conseil du 4 avril 2001, déjà citée, art. 2, i) indique, de façon tautologique, qu’un participant à un essai clinique est une « personne qui participe à un essai clinique », il précise aussitôt que l’un des critères suffisants de cette participation est de recevoir le médicament expérimental. Cette solution est, du reste, logique : la règle du consentement libre et éclairé serait dépourvue de sens si elle n’était destinée qu’à protéger les participants volontaires et cessait de s’appliquer quand les recherches interventionnelles sont pratiquées à l’insu des personnes ou lorsqu’elles les subissent sous contrainte. Par ailleurs, il ne serait pas acceptable que les participants à l’essai clinique soient soumis à un régime juridique plus favorable, en termes de droit à l’information durant les essais, droit de retrait à tout moment, droit à une assurance, etc., que les personnes non volontaires alors que la même substance leur est inoculée.
À cet égard, il est spécieux de prétendre que la vaccination, pour l’instant limitée à certaines catégories professionnelles, ne serait pas absolument obligatoire au motif que les intéressés auraient toujours le choix de changer de métier soit par démission, soit du fait d’un licenciement. En réalité, ce « choix » serait évidemment coercitif, puisqu’il impliquerait des pertes sévères pour qui refuserait de se conformer. Comme l’a expliqué le politologue Robert Dahl (L’analyse politique contemporaine, 1973), la coercition est « une forme de pouvoir qui existe chaque fois que A contraint B à acquiescer à sa demande en le confrontant uniquement à des alternatives impliquant de sérieuses privations ».
Or, l’éthique de la recherche médicale impliquant la personne humaine interdit tout recours à la coercition, même indirecte. La déclaration d’Helsinki à laquelle renvoie la directive européenne du 4 avril 2001 (déjà citée, art. 2) affirme que le médecin doit s’entourer de précautions si le sujet de l’essai clinique « doit donner son consentement sous la contrainte », car « le droit du sujet de sauvegarder son intégrité et sa vie privée doit toujours être respecté » (7). Le règlement européen du 16 avril 2014 (déjà cité, art. 28, 1, h) est encore plus explicite : « aucune contrainte, y compris de nature financière, n’est exercée sur les participants pour qu’ils participent à l’essai clinique ». Le préambule de ce texte apporte une autre précision intéressante : pour que le consentement éclairé puisse être donné librement il faut tenir compte « de toutes les circonstances pertinentes qui pourraient influencer la décision de participer à un essai clinique, notamment lorsque le participant potentiel appartient à une catégorie défavorisée sur le plan économique ou social ou lorsqu’il est dans une situation de dépendance institutionnelle ou hiérarchique susceptible d’influer de façon inopportune sur sa décision de participer ou non » (point 31).
* * *
En conclusion, les principes juridiques paraissent solidement établis pour considérer que la vaccination obligatoire porterait atteinte à des garanties fondamentales pour la protection des individus. Reste que ce que le législateur a fait, il peut toujours le défaire et cela vaut aussi en matière de recherche médicale. Cela demanderait néanmoins de détricoter un écheveau complexe de règles juridiques, un empilement de normes dont la loi Jardé de 2012 n’est qu’un élément et auquel il faudrait ajouter de nombreuses règles de droit du travail, de droit civil, de droit pénal, etc. Or, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire qui instaure la vaccination obligatoire dans une précipitation organisée, ne le fait pas. En l’état, la nouvelle loi prévoit donc l’inoculation obligatoire d’un médicament immunologique expérimental, ce qu’une autre loi, au moins, interdit. Par ailleurs, la France se met en contradiction avec le droit supranational, car cette loi est contraire non seulement au droit de l’Union européenne, mais aussi à la Convention d’Oviedo du 4 avril 1997 sur les droits de l’homme et la biomédecine qui affirme le principe du consentement libre et éclairé et qui a force obligatoire depuis 2011 sur le sol français.
L’une des caractéristiques de l’État de droit est la soumission de l’État aux règles qu’il a lui-même énoncées. Si les gouvernants ne tiennent plus compte de ces dernières et leur portent atteinte, cela ne peut signifier qu’une chose : l’État de droit cède la place à l’arbitraire. Il faut alors espérer que les juges sauront ramener les gouvernants à la raison juridique. Car en matière d’éthique médicale, nous avons derrière nous un siècle de réflexion fondée sur un certain nombre de drames et trente ans de législation éclairée qui ont posé des garde-fous pour la sauvegarde de tous. Sommes-nous réellement prêts à les anéantir sans discussion ? À fermer les yeux en considérant que cela ne concerne qu’une fraction de la population ? Il y a urgence à se souvenir que chaque fois qu’une garantie essentielle est enlevée à quelqu’un, elle le sera possiblement à tous demain.
Notes
(1) Lorsqu’il s’agit de « répondre à des besoins non satisfaits des patients », c’est-à-dire en l’absence de traitement alternatif autorisé, notamment pour prévenir des maladies « mettant la vie en danger ».
(2) Ce que confirme l’INSERM qui les identifie toutes à des recherches interventionnelles : « Les essais cliniques (recherches interventionnelles portant sur un produit de santé) », déjà cité.
(3) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, déjà citée (art. 1-4). Par ailleurs, « toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme en vue (…) de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez l’homme est également considérée comme médicament ».
(4) Il s’agit d’un médicament expérimental autorisé par l’Agence européenne du médicament conformément au règlement (CE) n°726/2004, déjà cité (art. L5121-1-1 du Code de la santé publique).
(5) C’est la loi du 20 décembre 1988, dite loi Huriet-Sérusclat, qui a autorisé pour la première fois les essais médicaux sur des volontaires en bonne santé – jusqu’alors interdits – tout en rappelant la nécessité d’un « consentement libre, éclairé et exprès ». Pour un exposé des principes éthiques gouvernant la philosophie du droit français, voir notre étude déjà citée.
(6) Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001, déjà citée (art. 3, d-e). Le règlement du 16 avril 2014, qui devrait se substituer à cette directive d’ici la fin de l’année 2021, affirme de même : un essai clinique ne peut être conduit que « si les participants (…) ont donné leur consentement éclairé » (Règlement (UE) n°536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, déjà cité, art. 28, 1, c). L’urgence ne fait figure d’exception que si « l’essai clinique se rapporte directement à la condition médicale du participant en raison de laquelle il est impossible, dans le temps imparti pour instituer le traitement, d’obtenir au préalable [son] consentement éclairé » (art. 35.1.e).
(7) Déclaration d’Helsinki sur les principes éthiques applicables aux recherches médicales sur des sujets humains, adoptée en 1964 par l’Association médicale mondiale (art. I. 10 et I. 6, pour la version de 1996). En ligne ici.